Événement labellisé SFSIC
- Du au
Lieu de l’événement Université Grenoble Alpes, Grenoble
Le colloque « “Nouvelles agentivités” et pratiques info-communicationnelles en santé ? » se tiendra les 23 et 24 octobre 2025 à Grenoble. Accueilli et organisé par le GRESEC à l’Université Grenoble Alpes, il est organisé dans le cadre du GER ICOS (Information et communication en santé) en collaboration avec CIMEOS, DICEN-IDF, IMSIC, LERASS, la Chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques en santé et le CTI Lab de l’université d’Ottawa. Les propositions de contributions sont attendues pour le 21 avril.
Présentation
Ce colloque fédère des recherches qui s’intéressent aux pratiques info-communicationnelles, intégrant des dispositifs variés mis en œuvre dans le champ de la santé. Face à la crise structurelle que rencontre la santé dans la plupart des pays et aux tensions que vivent les acteurs professionnels du domaine médical et paramédical, ce colloque est l’occasion de penser la place de « l’humain » dans divers contextes.
Il s’agira plus précisément de se saisir de la notion « d’agentivité » qui interroge aussi bien les intentionnalités au sens performatif de la pragmatique que les actions engagées avec ou sans les dispositifs techniques et l’intelligence artificielle (IA) ; les formes d’actions des individus, des groupes sociaux, des associations, des syndicats et des professionnels au sein des établissements de santé ; la mise en œuvre des politiques de santé publique et leur glissement du curatif vers les discours de prévention.
Les contextes sont multiples et favoriseront une réflexion à un niveau macro sur l’évolution des politiques d’information et de communication liées aux systèmes de santé, sur l’analyse des idéologies sous-jacentes aux innovations de santé et sur la compréhension des discours et pratiques qui accompagnent la technologisation de ce secteur. En effet, au sein des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de santé, etc.), les acteurs vivent des situations difficiles, voire de souffrance au travail, malgré la mise en place de dispositifs organisationnels qui cherchent à maintenir la cohérence, la cohésion et la justice sociale. Des tensions sont tangibles et ont des conséquences sur les pratiques professionnelles, sur les usages des dispositifs d’information et communication, sur le rapport à la documentation et aux archives. Enfin, au niveau des individus, leur intégration dans le système de santé comme « responsables de leur propre santé » soulève également des questions sur la nature des savoirs en circulation, sur les formes de partage des expériences individuelles ou collectives, sur leur représentation dans les démarches de co-design. Concernant les techniques et les technologies de santé, les valeurs humaines de solidarité et de résilience sont questionnées dans le contexte des recherches sur l’innovation et la créativité. Les patients, enrôlés dans la conception de ces dispositifs innovants, participent aux expériences situées et leur vécu est intégré dans le processus de conception. Les usages et mésusages des dispositifs interrogent les relations entre patients, soignants et machines et posent la question du sens des “nouvelles” pratiques de soin.
Les interventions avec prises de risques théoriques et méthodologiques seront appréciées et devront s’intégrer dans les axes présentés ci-après.
Axe 1 : Enjeux sociopolitiques, socio-économiques et culturels de la santé
Responsables scientifiques : Michel Durampart (IMSIC, Université de Toulon), Eloria Vigouroux-Zugasti (GRESEC, Université Grenoble Alpes), Hélène Romeyer (CIMEOS, Université de Bourgogne)
Cet axe explore les enjeux sociopolitiques, socio-économiques et culturels des transformations contemporaines de la santé, notamment la crise des systèmes sanitaires, l’essor des technologies et plateformes numériques, l’apparition de nouveaux acteurs et formes de coopération. Une attention particulière sera portée aux tensions entre utopies technologiques et réalités socio-économiques, entre États, collectivités et territoires, notamment à l’échelle internationale. Les systèmes de santé sont confrontés à une crise multiforme, exacerbée par le vieillissement des populations, l’augmentation des maladies chroniques et les innovations technologiques. La médecine 4P – personnalisée, préventive, prédictive et participative – se présente comme une réponse aux défis sanitaires. Toutefois, sa mise en œuvre soulève des enjeux complexes, dont la formation et l’intégration des patients « experts » et des questions éthiques, politiques et économiques majeures en découlent. Si ces innovations portent des espoirs, elles peuvent aussi entraîner de nouvelles formes de gouvernementalité algorithmique et de déshumanisation.
Dans ce contexte, la numérisation des soins, l’introduction d’algorithmes prédictifs et l’émergence de plateformes numériques participent à la technicisation du secteur, mettant en question la place de l’humain dans les soins. Les plateformes comme Doctolib et les outils d’auto-diagnostic redéfinissent les pratiques médicales, tout en soulevant des problématiques de sécurité des données et d’équité d’accès, quels que soient les territoires et les communautés. C’est ce contexte de reconfiguration voire de déstabilisation des systèmes de santé qui demande alors à être étudié au regard des tensions qu’ils traversent.
Axe 2 : Datafication de la santé, reconfigurations algorithmiques du corps et des affects
Responsables scientifiques : Sylvie Grosjean (CTI Lab, Université d’Ottawa), Olivier Galibert (CIMEOS, Université de Bourgogne)
Cet axe nous invite à réfléchir aux implications de l’intégration des systèmes d’information alimentés ou non par de l’intelligence artificielle (IA), sur les pratiques organisationnelles, médicales et l’éthique du soin. Il propose de questionner le mouvement de datafication de la santé où le soin, le corps et les affects deviennent données, en soulignant notamment les opportunités, tensions et recompositions des pratiques organisationnelles, cliniques et relationnelles.
La généralisation des systèmes d’intelligence artificielle redéfinit la manière dont le soin – en tant que pratique, relation et éthique – est conçu et exercé. Dans un contexte de santé dite algorithmique, le soin se transforme en processus de gestion des données : collecte, traitement et modélisation traduisent les corps, les pathologies et les interactions cliniques en métriques et indicateurs. Ce processus de datafication de la santé soulève des questions de formation, d’éducation, de professionnalisation et d’analyse de la manière dont le soin est vécu, organisé et reconfiguré. Ces systèmes algorithmiques tendent à redéfinir la place de l’humain dans la prise de décision – organisationnelle ou clinique – en automatisant certaines procédures, en présentant des données, indicateurs, informations qui vont “faire autorité”. Enfin, travailler avec et sur les données générées par des systèmes d’IA repose sur divers outils de visualisation qui ne sont pas neutres et vont concentrer un volume important d’indicateurs rendant visibles des tendances, des anomalies, mais aussi les activités quotidiennes. La manière dont les données sont discutées, mobilisées, interprétées soulève la question de leur performativité, leur biais, et leur rôle dans la prise de décision.
Axe 3 : Connaissances, savoirs en santé : recompositions des publics, des dispositifs et des expertises
Responsables scientifiques : Viviane Clavier (GRESEC, Université Grenoble Alpes), Céline Paganelli (LERASS, Université de Montpellier Paul Valéry), Sylvie Parrini-Alemanno (DICEN-IDF, CNAM)
Cet axe s’attache à la diversité des savoirs qui se déploient dans des espaces variés et qui jouent un rôle central dans la manière dont la santé est abordée à l’échelle individuelle et collective. D’un côté, les savoirs experts, fondés sur la science, les recherches cliniques et les pratiques professionnelles guident les politiques de santé publique et les stratégies de prévention. De l’autre, les savoirs profanes, issus d’expériences individuelles, de récits personnels, permettent de comprendre la manière dont les personnes perçoivent, comprennent et gèrent leur santé. Des espaces de dialogue et de controverses, de formation et d’éducation favorisent leurs rencontres, comme les réseaux de patients experts notamment.
Les typologies classiques sur les savoirs experts versus profanes méritent d’être questionnées alors même que l’IA participe à la production des connaissances et que les expériences des patients et des soignants sont converties en données. Dans un contexte de défiance des populations vis-à-vis des politiques de santé publique et de montée en puissance des phénomènes de désinformation (fake news), il est intéressant d’observer les pratiques informationnelles et médiatiques des professionnels et des patients, d’étudier les modalités de recomposition des littératies à l’œuvre dans les usages des dispositifs d’information, de prévention ou d’éducation à la santé. L’analyse des formes de médiation doit considérer la diversité des publics – jeunes, séniors, précaires, handicapés, malades, etc. – et des pratiques, les types de pathologies et leurs conséquences sur le rapport à l’information, le rôle des formateurs et les formes d’évaluation des dispositifs et des connaissances.
Axe 4 : Nouvelles écologies réflexives, activités, pratiques et expériences en santé
Responsables scientifiques : Fabienne Martin-Juchat (GRESEC, Université Grenoble Alpes), Valérie Lépine (LERASS, Université de Montpellier Paul Valéry) et Philippe Bonfils (IMSIC, Université de Toulon)
Cet axe se focalise sur l’observation et l’analyse des bricolages au plus près des expériences et des vécus des acteurs et des patients. Les démarches de co-construction, de co-conception et de co-design dans leurs promesses méritent d’être évaluées au regard de la complexité, de la lourdeur et de la difficulté de leur mise en œuvre. Les relations construites avec des outils numériques quantifiant la maladie ambitionnent d’être encapacitantes (par le biais de nouvelles narrativités) et non réifiantes ou anxiogènes pour le sujet malade. Les vécus expérientiels n’étant pas uniquement exprimables que par des mots, en particulier quand ils se jouent des relations sensorielles et émotionnelles avec les agents non humains, les méthodologies pour rendre compte des nouvelles formes de coopérations et de relations entre les humains et les non-humains (de type chatbots et robots en santé) sont à inventer.
En particulier, observer et comprendre les nouvelles formes d’empathie, de coordination et de coopération entre les agents humains et non humains (animaux, plantes, robots sociaux). De plus, ce type d’approche nécessite l’autorisation de révéler des dimensions du travail autour du soin, de soi et des autres. Le consentement à révéler le travail émotionnel des acteurs incluant celui des patients se présente comme une difficulté à la fois théorique et méthodologique à aborder dans un contexte de prévention éthique.
Références indicatives
Ajana B., Braga J., Guidi S., (2022), The quantification of bodies in health : multidisciplinary perspectives, Bingley : Emerald publishing.
Alemanno, S., Delille, P., (2023), « Design participatif pour la littératie en santé environnementale », Approches Théoriques en Information-Communication (ATIC) N° 6(1), 89-108.https://doi.org/10.3917/atic.006.0089
Collet, L., Durampart, M., Heiser. L., Picard, L., (2021), « Enjeux expérientiels de l’utilisation de l’IA en anatomopathologie », Communiquer, 33, 26-44. doi.org/10.4000/communiquer.8819
Cordelier B., Galibert, O., (2021), Communications numériques en santé, Londres : ISTE Editions.
Corroy, L., Chauzal-Larguier. C., (2023), Patients, Caregivers and Doctors : Devices, Issues and Representations, ISTE, Communication and Health Set, 9781786308931. ⟨hal-04228333⟩
Davat, A., Martin-Juchat, F., Ménissier T., (2024), « Co-design with affect stories and applied ethics for health technologies », Frontiers in Communication, Sec. Health Communication, vol. 9, 2024. doi.org/10.3389/fcomm.2024.1327711
Georges, F. (2009), « Représentation de soi et identité numérique », Réseaux, vol. 2, n° 154, 165-193. doi.org/10.3917/res.154.0165
Granjon, F., Nikolski, V., & Pharabod, A.-S., (2012), « Métriques de soi et self-tracking : Une nouvelle culture de soi à l’ère du numérique et de la modernité réflexive ? », Recherches en Communication, 36, 13-26. doi.org/10.14428/rec.v36i36.50983
Grosjean, S., (2022), Le co-design de technologies de eSanté : Un enchevêtrement de conversations, de tensions créatrices et d’inscriptions circulantes. Approches Théoriques en Information-Communication (ATIC), 4(1), 103-125. doi.org/10.3917/atic.004.0103
Klein, A., (2008), “La santé comme norme de soin”, Philosophia Scientiæ, Travaux d’histoire et de philosophie des sciences, 12- 2 : doi.org/10.4000/philosophiascientiae.127
Mayère A., (2018), « Patients projetés et patients en pratique dans un dispositif de suivi à distance : Le “travail du patient” recomposé ». Réseaux, vol. 1, n°207, 197–225. doi.org/10.3917/res.207.0197
Paganelli C., Clavier V., (dir.) (2023), Pratiques d’information et connaissances en santé, vol. 5, Londres : ISTE Editions.
Sampic, M., Lépine, V., Mignot, P,. (2023), « Communication et régionalisation des centres de dépistages des cancers », Communication & Organisation, n° 63(1), 173-187.
Schön, D. A., (2017), The reflective practitioner : How professionals think in action, London, Routledge.
Vigouroux-Zugasti, E., Bourret, C., (2023), « La santé au prisme de la communication organisationnelle : enjeux, tensions et perspectives », Communication et organisation, 63, 2023, 11-18.
Modalités de soumission
Pour les communications :
- Page de garde avec le titre de la communication, la liste des auteurs et leurs affiliations
- Préciser l’axe dans lequel s’inscrit la communication
- Résumé de 10000 signes espaces compris (bibliographie non comprise) : ce document doit être anonymisé
Pour les posters (réservés aux doctorant.e.s et post-doctorant.e.s) :
- Page de garde avec le titre du poster, la liste des auteurs et leurs affiliations
- Préciser l’axe dans lequel s’inscrit le poster
- Présentation du poster anonymisé incluant le contexte, objectifs de la recherche, méthodologie, résultats et contribution scientifique.
Calendrier
Soumission le 21 avril 2025 à envoyer à :
- viviane.clavier@univ-grenoble-alpes.fr
- fabienne.martin-juchat@univ-grenoble-alpes.fr
- eloria.vigouroux-zugasti@univ-grenoble-alpes.fr
Notification d’acceptation le 15 juillet 2025
Dans la continuité de cette manifestation, la revue Les Enjeux de l’information et de la communication lancera un appel à contribution sur la thématique du colloque en novembre 2025 coordonné par Viviane Clavier, Fabienne Martin-Juchat et Eloria Vigouroux-Zugasti
Comité scientifique en cours de constitution
Laurence Corroy (CREM, Université de Lorraine)
Viviane Clavier (GRESEC, Université Grenoble Alpes)
Philippe Bonfils (IMSIC, Université de Toulon)
Luc Bonneville, (Universté d’Ottawa)
Christian Bourret (DICEN-IDF, Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
Jean-Philippe De Oliveira (ELICO, Univesité Jean Moulin Lyon 3)
Maria Cherba (Université d’Ottawa)
Benoit Cordellier (UQAM Montréal)
Michel Durampart (IMSIC, Université de Toulon)
Olivier Galibert (CIMEOS, Université de Bourgogne)
Sylvie Grosjean (CTI Lab, Université d’Ottawa)
Fabienne Martin-Juchat (GRESEC, Université Grenoble Alpes)
Pierre Mignot (LERASS, Université Toulouse 3 Paul Sabatier)
Aurélie Laborde (MICA, Université Bordeaux Montaigne)
Valérie Lépine (LERASS, Université de Montpellier Paul Valéry)
Caroline Ollivier Yaniv, CEDITEC, (Université Paris Est Créteil)
Céline Paganelli (LERASS, Université de Montpellier Paul Valéry)
Sylvie Parrini-Alemanno (DICEN-IDF, CNAM)
Hélène Romeyer (CIMEOS, Université de Bourgogne)
Eloria Vigouroux-Zugasti (GRESEC, Université Grenoble Alpes)
Partenaires

CIMEOS
CIMEOS

DICEN-IDf – Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ere Numérique – Paris, Ile-de-France
DICEN-IDf

IMSIC – Institut Méditerranéen des Sciences de l’Information et de la Communication
IMSIC
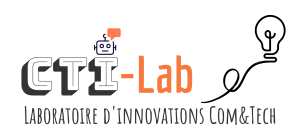
CTI-Lab
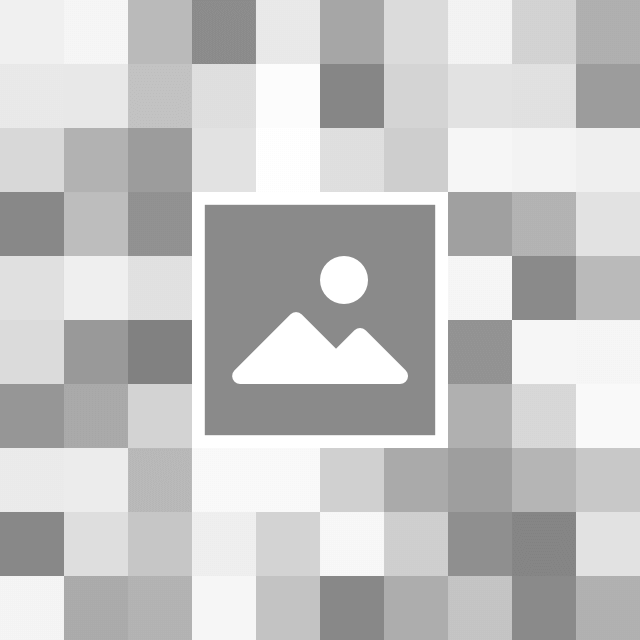
Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa
Mots-clés
- Mots-clés
- Santé